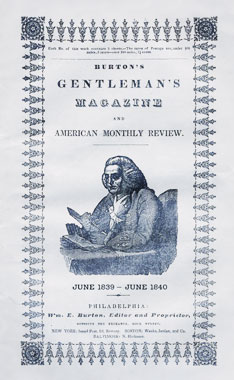
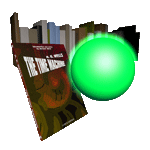
The Fall Of the House Of Usher (1839)
Sorti aux USA en septembre 1839 dans le magazine mensuel pour les Gentlemen de William Evans Burton de Philadelphie.
Traduit en français par Charles Baudelaire en 1884. Très nombreuses éditions françaises sous les titres Contes étranges, Histoires extraordinaires et Nouvelle Histoires Extraordinaires. La nouvelle inclue le poème Le Palais Hanté.
De Edgar Allan Poe.
Pour adultes et adolescents.
(horreur totale) un ami d’enfance rend visite à Roderick et Madeline Usher, un frère et une sœur jumelle atteints de dépression, un mal apparemment héréditaire.
***
Le texte original d’Edgar Allan Poe de 1839 pour le magazine Burton.
Domaine public.
THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
------------
BY EDGAR A. POE.
------------
During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year, when the clouds hang oppressively low in the heavens, I had been passing alone, on horseback, through a singularly dreary tract of country ; and at length found myself, as the shades of the evening drew on, within view of the melancholy House of Usher. I know not how it was—but, with the first glimpse of the building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. I say insufferable ; for the feeling: was unrelieved by any of that hnlf-pleasurable, because poetic, sentiment, with which the mind usually receives even the sternest naitural images of the desolate or terrible.
I looked upon the scene before me—upon the meree house, and the simple landscape features of the domain—upon the bleak walls—upon the vacant eye-like windows—upon a few rank sedges—and upon a few white trunks of decayed trees—with an utter depression of soul which I can compare to no earthly sensation more properly than to the after-dream of the reveller upon opium—the bitter lapse into common life—the hideous dropping off of the veil. There was an iciness, a sinking, a sickening of the heart—an unredeemed dreariness of thought which no goading of the imagination could torture into aught of the sublime.
What was it—I paused to think—what was it that so unnerved me in the contemplation of the House of Usher ? It was a mystery all insoluble ; nor could I grapple with the shadowy fancies that crowded upon me as I pondered. I was forced to fall back upon the unsatisfactory conclusion, that while, beyond doubt, there are combinations of very simple natural objects which have the power of thus affecting us, still the reason, and the analysis, of this power, lie among considerations beyond our depth. It was possible, I reflected, that a mere different arrangement of the particulars of the scene, of the details of the picture, would be sufficient to modify, or perhaps to annihilate its capacity for sorrowful impression ; and, acting upon this idea, I reined my horse to the precipitous brink of a black and lurid tarn that lay in unruffled lustre by the dwelling, and gazed down—but with a shudder even more thriving than before—upon the re-modeled and inverted images of the gray sedge, and the ghastly tree-stems, and the vacant and eye-like windows.
Nevertheless, in this mansion of gloom I now proposed to myself a sojourn of some weeks. Its proprietor, Roderick Usher, had been one of my boon companions in boyhood ; but many years had elapsed since our last meeting. A letter, however, had lately reached me in a distant part of the country—a letter from him—which, in its wildly importunate nature, had admitted of no other than a personal reply. The MS. gave evidence of nervous agitation. The writer spoke of acute bodily illness—of a pitiable mental idiosyncrasy which oppressed him—and of an earnest desire to see me, as his best, and indeed, his only persona! friend, with a view of attempting, by the cheerfulness of my society, some alleviation of his malady. It was the manner in which all this, and much more, was said—it was the apparent heart that went with his request—which allowed me no room for hesitation—and I accordingly obeyed, what I still considered a very singular summons, forthwith.
Sources :
Archive.org Burton's
Wikisource.
***
La traduction au plus proche
LA CHUTE DE LA MAISON USHER
------------
PAR EDGAR A. POE.
------------
Pendant la totalité d’une triste, sombre et silencieuse journée durant l’automne de cette année-là, quand les nuages pesaient oppressivement bas dans les cieux, j’avais été à passer seul, à dos de cheval, par un chemin de terre de campagne singulièrement lugubre ; et à force me retrouvait, alors que les ombres du soir s’allongeaient, à portée de vue de la mélancolique maison des Ushers. Je ne sais comment cela se faisait—mais, au premier aperçu du bâtiment, un sentiment d’insoutenable tristesse infusa mon humeur. Je dis insoutenable, parce que le sentiment était sans aucun mélange de ces demi-plaisirs, induits par la poésie, par ces libres associations qui font que l’esprit habituellement accepte même les plus frustres images de désolation ou d’épreuve.
Je contemplais le paysage qui s’étalait devant moi—Ia maison isolée, et les attributs frustres de l’entour—les murs sordides , les fenêtres tels des yeux hagards—les rangées de broussailles—et les rares troncs blancs des arbres dépouillés—avec l’absolu dépression de l’âme que je ne pourrais plus exactement comparer à aucune sensation terrestre sinon à la descente de l’opiomane—l’amer retour à la vie ordinaire—l’hideuse révélation une fois le voile tombé. Il y avait le gel, puis le chavirement, et le retournement du cœur—un délavement irrémédiable de la pensée qu’aucun éperon de l’imagination n’aurait pu par la torture sublimer d’un seul degré du sublime.
Qu’est-ce qui—je fais halte pour y réfléchir—Qu’est-ce qui m’agaçait à ce point dans la contemplation de la Maison des Usher ? C’était un mystère des plus insoluble ; pas davantage je ne pouvais avoir prise sur les délires morbides qui grouillaient autour de moi comme je m’interrogeais. J’étais forcé d’en revenir à la conclusion frustrante, que tandis que, sans doute possible, la combinaison d’objets naturels très simples qui avaient le pouvoir de nous affecter de la sorte, la raison, l’analyse de ce pouvoir nous échappait encore. Il était possible, je réfléchissais, qu’un arrangement à peine différent des particularités de cette scène, des détails de l’image, auraient suffi à modifier, ou peut-être annulé sa capacité à imprimer le chagrin ; et suivant cette idée, je tirais sur les rênes, faisant reculer mon cheval jusqu’aux berges abruptes d’un trou d’eau noir et lugubre miroitant sans ride au bas de la demeure, et je baissait les yeux—m ais je fus parcouru d’un frisson encore plus prononcé qu’auparavant — à la vue des images remodelées et inversées des broussailles grises, des arbres squelettiques et des fenêtres telles des yeux hagards.
Néanmoins, dans ce manoir de détresse, je m’étais proposé désormais un séjour de quelques semaines. Son propriétaire, Roderick Usher, avait été l’un de mes bons compagnons d’enfance ; mais de nombreuses années s’étaient écoulées depuis notre dernière rencontre. Une lettre, toutefois, m’avait tantôt été remise dans une partie reculée du pays—une lettre de lui—laquelle, de par sa nature tout à fait dérangeante, ne pouvait admettre rien d’autre qu’une réponse personnelle. L’écriture en dénotait une agitation nerveuse. L’auteur parlait d’une maladie physique aiguë—d’une pitoyable tempérament qui l’oppressait—et du désir impérieux de me voir, en tant que son meilleur, et de fait, son seul ami proche, avec la visée de tenter, par la joie de ma société, de soulager quelque peu son mal. C’était la manière dans lequel tout cela et beaucoup plus était dit—le cœur qu’il avait apparemment mis dans sa requête—qui ne me laissait aucune place à l’hésitation—et, en conséquence, j’obéis à ce que je considérais encore comme une convocation très singulière — sans délai.
***
La traduction de Charles Baudelaire de 1884 pour A. Quantin.
Domaine public.
LA CHUTE DE LA MAISON USHER
Son cœur est un luth suspendu ;
Sitôt qu’on le touche, il résonne.
DE BERANGER.
Pendant toute une journée d’automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourd et bas dans le ciel, j’avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvai en vue de la mélancolique Maison Usher. Je ne sais comment cela se fit, — mais, au premier coup d’œil que je jetai sur le bâtiment, un sentiment d’insupportable tristesse pénétra mon âme. Je dis insupportable, car cette tristesse n’était nullement tempérée par une parcelle de ce sentiment dont l’essence poétique fait presque une volupté, et dont l’âme est généralement saisie en face des images naturelles les plus sombres de la désolation et de la terreur.
Je regardais le tableau placé devant moi, et, rien qu’à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, — les murs qui avaient froid, — les fenêtres semblables à des yeux distraits, — quelques bouquets de joncs vigoureux, — quelques troncs d’arbres blancs et dépéris, — j’éprouvais cet entier affaissement d’âme, qui, parmi les sensations terrestres, ne peut se mieux comparer qu’à l’arrière-rêverie du mangeur d’opium, — à son navrant retour à la vie journalière, — à l’horrible et lente retraite du voile. C’était une glace au cœur, un abattement, un malaise, — une irrémédiable tristesse de pensée qu’aucun aiguillon de l’imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand.
Qu’était donc, — je m’arrêtai pour y penser, — qu’était donc ce je ne sais quoi qui m’énervait ainsi en contemplant la Maison Usher ? C’était un mystère tout à fait insoluble, et je ne pouvais pas lutter contre les pensées ténébreuses qui s’amoncelaient sur moi pendant que j’y réfléchissais. Je fus forcé de me rejeter dans cette conclusion peu satisfaisante, qu’il existe des combinaisons d’objets naturels très simples qui ont la puissance de nous affecter de cette sorte, et que l’analyse de cette puissance gît dans des considérations où nous perdrions pied. Il était possible, pensais-je, qu’une simple différence dans l’arrangement des matériaux de la décoration, des détails du tableau, suffit pour modifier, pour annihiler peut-être cette puissance d’impression douloureuse ; et, agissant d’après cette idée, je conduisis mon cheval vers le bord escarpé d’un noir et lugubre étang, qui, miroir immobile, s’étalait devant le bâtiment ; et je regardai — mais avec un frisson plus pénétrant encore que la première fois — les images répercutées et renversées des joncs grisâtres, des troncs d’arbres sinistres, et des fenêtres semblables à des yeux sans pensée.
C’était néanmoins dans cet habitacle de mélancolie que je me proposais de séjourner pendant quelques semaines. Son propriétaire, Roderick Usher, avait été l’un de mes bons camarades d’enfance ; mais plusieurs années s’étaient écoulées depuis notre dernière entrevue. Une lettre cependant m’était parvenue récemment dans une partie lointaine du pays, — une lettre de lui, — dont la tournure follement pressante n’admettait pas d’autre réponse que ma présence même. L’écriture portait la trace d’une agitation nerveuse. L’auteur de cette lettre me parlait d’une maladie physique aiguë, — d’une affection mentale qui l’oppressait, — et d’un ardent désir de me voir, comme étant son meilleur et véritablement son seul ami, — espérant trouver dans la joie de ma société quelque soulagement à son mal. C’était le ton dans lequel toutes ces choses et bien d’autres encore étaient dites, — c’était cette ouverture d’un cœur suppliant, qui ne me permettait pas l’hésitation : en conséquence, j’obéis immédiatement à ce que je considérais toutefois comme une invitation des plus singulières.
Source : Wikisource
***

La Chute de la Maison Usher, la nouvelle de 1839
- Détails
- Écrit par David Sicé
