
Dragons, le film animé de 2010
- Détails
- Écrit par David Sicé
- Catégorie : Blog
- Affichages : 3227

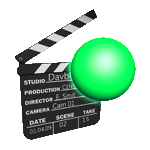
How To Train Your Dragon (2010)
Traduction du titre original : Comment entraîner votre Dragon.
Ici l'article de ce blog sur la série animée télévisée : Dragons: Cavaliers de Beurks (2012, Dragons: Riders Of Berk)
Ici l'article de ce blog sur le film Dragons 2 (animé, 2014, How To Train Your Dragon 2)
Sorti aux USA le 26 mars 2010.
Sorti en France et en Angleterre le 31 mars 2010.
Sorti en blu-ray américain le 15 octobre 2010 (multi-régions, anglais Dolby True HD 5.1, français DD 5.1)
Sorti en blu-ray français le 2 novembre 2010.
Sorti en blu-ray américain 3D le 6 septembre 2011 (multi-régions, anglais Dolby True HD 7.1, français DD 5.1)
De Dean DeBlois et Chris Sanders (également scénaristes) ; sur un scénario de William Davies ; d'après le roman Comment dresser votre dragon (2003, How To Train Your Dragon) de Cressida Cowell ; avec Jay Baruchel, America Ferrera, Gerard Butler, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, Kristen Wiig, T.J. Miller , Craig Ferguson, Robin Atkin Downes, Philip McGrade, Kieron Elliott, Ashley Jensen, David Tennant.
Pour tout public.
Voici Berk. C’est à douze jour au nord du désespoir et quelques degrés au sud de mourir congelé. C’est solidement ancré sur le méridien de la misère. Le village : en un mot, robuste. Il se trouve là depuis sept générations mais toutes les constructions sans aucune exception sont neuves. Ils ont la pêche, la chasse, et une vue charmante sur les couchers de soleil. Le seul problème, ce sont les nuisibles. Vous voyez, la plupart des endroits ont des souris ou des moustiques. Eux, ils ont des… dragons.
La plupart des gens quitteraient les lieux. Pas eux. Ce sont des Vikings. Ils ont un petit problème d’obstination. Son nom à lui, c’est Hoquet. Un nom génial, il le sais. Mais ce n’est pas le pire. Les parents croient qu’un nom hideux fera fuir les gnomes et les trolls. Comme si notre comportement charmant de Viking n’en était pas déjà capable... Cette nuit-là, une horde de dragons a donc attaqué Berk une fois de plus et tout le village est dehors, à courir dans tous les sens. Hoquet, qui est petit et frêle, sait où il va, lui – mais il est constamment bousculé par son père, le chef de la tribu, Stoïck le Vaste, ou les autres membres de la communauté, qui lui demandent tous ce qu’il fait dehors et lui ordonnent invariablement d’aller s’abriter.
On dit que lorsque Stoïck était un bébé, il fit sauter net la tête d’un dragon de ses épaules. Est-ce que Hoquet y croit ? Oui, il le croit. Un guerrier fait son rapport à Stoïck : ils ont toutes les sortes de dragon, sauf des Furieux de la Nuit, et pour Stoïck, c’est une bonne chose. Pendant ce temps, Hoquet arrive enfin à son poste : il est l’apprenti du forgeron du village. Comme le forgeron commençait à se demander si Hoquet n’avait pas été mangé, celui-ci répond en soulevant avec peine une masse, qu’il est bien trop musclé pour intéresser un dragon – ils ne sauraient quoi faire de toute sa maigreur. Le forgeron – Gobber (mangeur de motte), dont la main droite a été remplacée par une prothèse de métal interchangeable – lui répond que les dragons ont sûrement besoin de cure-dents.
Pendant ce temps, les dragons cracheurs de feu incendient les toits des maisons du village les unes après les autres. Vous voyez ? Un vieux village – beaucoup, mais vraiment beaucoup de nouvelles maisons…


***
Donnez votre avis sur ce film animé en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr
***
Alice au Pays des Merveilles, le film de 2010
- Détails
- Écrit par David Sicé
- Catégorie : Blog
- Affichages : 3998


Alice in Wonderland (2010)
Noter que ceci n'est pas une adaptation fidèle du roman de Lewis Carroll.
Sorti en Angleterre et aux USA le 5 mars 2010.
Sorti en France le 24 mars 2010.
Sorti en blu-ray américain 2D le 1er juin 2010 (multi-régions, français inclus).
Sorti en blu-ray français 2D le 24 juin 2010.
Sorti en blu-ray français 3D le 3 novembre 2010.
Sorti en blu-ray américain 3D le 7 décembre 2010 (multi-régions, français inclus).
De Tim Burton ; sur un scénario de Linda Woolverton, d'après les romans de Lewis Carroll ; avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Matt Lucas, Michael Sheen, Stephen Fry, Alan Rickman, Barbara Windsor, Paul Whitehouse, Timothy Spall, Marton Csokas.
Pour adultes et adolescents.
Un hôtel particulier victorien. Les investisseurs de Charles Kingsleigh pensent qu’il a perdu la tête. La plaidoirie de Charles est interrompue par sa petite fille, qui s’est levée en pleine nuit pour se plaindre d’un cauchemar bizarre rempli de créature. Étrangement aucun personnel ne semble veiller sur la petite fille, et Charles, son père, vient personnellement la consoler et la border, laissant en plan ses investisseurs qui, fort commodément, ne se plaignent pas du dérangement.
Des années plus tard, Alice est devenue une jeune fille rebelle de 19 ans, que sa mère conduit à une grande fête alors qu’elle n’a même pas pris la peine de mettre des bas, ce qui à l’époque lui aurait normalement valu d’être punie à coup de baguettes. Alice se plaint d’avoir encore fait le même cauchemar, et sa mère lui remet un pendentif. Arrivée en retard à la fête chez l’homme qui a racheté la compagnie de Charles, Alice se plie aux rituels des danses carrées avec pour partenaire le roux Lord Hmish, et comme elle explique pourquoi elle s’en amuse, Hamish, très guindé, la prie de garder ses explications pour elle-mêmes, et s’indigne qu’elle ne cesse de penser à des choses impossibles. Et comme la mère d’Alice fait signe au jeune homme, celui-ci lui donne rendez-vous dans un quinze minute au kiosque.
Alice apprend alors que Hamish va la demander en mariage et que toute la fête a été réunie pour l’annonce de leurs fiançailles. Pour la grande sœur d’Alice, tout cela est dans l’ordre des choses, mais Alice se demande s’il ne faudrait mieux pas qu’ils s’aiment d’abord. Puis la mère de Hamish demande à Alice de l’accompagner lors d’une promenade dans le jardin, pour lui parler de la meilleure manière de nourrir son futur mari. Mais comme sa future belle-mère lui raconte qu'elle a choisi Alice parce qu'elle ne supportait pas l'idée d'avoir des petits-enfants laids, elle s’indigne que les jardiniers aient planté des roses blanches au lieu de rouges. Cependant Alice ne s’intéresse qu’aux étranges mouvements des buissons. Et lorsque vient le moment de répondre publiquement à la demande de Hamish dans le kiosque sous le regard de tous les invités réunis, Alice aperçoit un lapin blanc en costume et avec une montre à gousset – et plante alors tout le monde pour poursuivre l’étrange animal à travers le parc, jusqu’à la souche d’un vieil arbre mort, avec un trou énorme à sa racine.
Comme Alice se penche et appelle, le rebord cède et elle tombe dans un puits sans fond, étrangement meublé, et avec des objets volants dans toutes les directions. Elle passe alors à travers un sol carrelé et se retrouve au plafond la tête en bas ; puis chute sur le sol. Alice essaie alors en vain toutes les portes : elles sont fermées à clé. Elle trouve alors une clé sur le guéridon au centre de la salle, mais la clé n’ouvre aucune des portes ; elle tire un rideau et découvre que la clé ouvre une porte minuscule, par laquelle elle ne peut passer que la tête. Elle aperçoit alors un flacon posé au bord du guéridon – qui n’y était pas avant –, pose la clé, examine l’étiquette du flacon, qui dit « bois-moi », et comme elle se dit que tout cela n’est qu’un rêve, elle boit du contenu du flacon.
Alors Alice rétrécit à l’intérieur de sa robe – mais en sort dans un jupon à sa taille, juste pour réaliser qu’elle a oublié la clé de la porte. Alors, trois individus qui l’épient depuis la petite porte s’étonne qu’Alice ne se souvienne pas de tout cela depuis sa première fois, et l’un reproche à l’autre d’avoir amené la mauvaise Alice. Alice découvre alors une petite boite contenant un unique gâteau sur lequel il est écrit « Mange-moi » et en mange un bout. Cette fois, le gâteau la fait grandir, elle – et son jupon – jusqu’au plafond. Alice récupère la clé sur le guéridon, vide le reste du flacon, et revient à la bonne taille pour franchir la porte. Alice passe la porte et découvre un étrange jardin, luxuriant et biscornu, dans lequel elle est minuscule. Après avoir aperçu des insectes étranges, elle se retrouve face à des fleurs, une souri, le lapin blanc et deux enfants obèses – Tweedledee et Tweedledum, qui veulent l’emmener auprès d’un certain Absolem.
Absolem se révèle être une grosse chenille bleue enfumée sur un champignon, qui demande à vérifier si Alice est la vraie Alice. Pour se faire, il fait dérouler par le Lapin Blanc l’Oraculum, l’encyclopédie sur parchemin à dérouler du tout ce qui est arrivé dans Le Monde d’En-dessous, sous la forme d’un calendrier – posé sur le champignon d’à côté. Et selon l’Oraculum, sur lequel figure le dessin d’Alice encadrée par les frères Tweedle, ce jour serait celui de Griblig, de l’ère de la Reine Rouge. Absolem demande alors au Lapin Blanc de montrer à Alice le jour Frabjous – le jour où Alice fera du Jabberwocky un esclave.

***
It's a wonderful life (1946) le blu-ray anglais de 2009
- Détails
- Écrit par David Sicé
- Catégorie : Blog
- Affichages : 2655


It's a wonderful life (1946) le blu-ray anglais de 2009
Multi-régions, pas de version française.
Sorti en Angleterre le 2 novembre 2009 (lisible en France, pas de version française).
Sur le film : Un film clé de l'histoire du cinéma, une fable humaniste décrivant sans fard les épreuves de ceux qui veulent faire le bien face à ceux qui ne se gênent pas pour faire le mal, aux coups du sort et aux petits travers qui peuvent très bien coûter très cher. Cela pourrait être un mélo si ce n'était pas en prise avec la réalité et si bien joué que les scènes violentes psychologiquement sont difficiles à soutenir pour les âmes sensibles. Le côté fantastique de l'histoire est au service de la fable avant tout, mais là aussi la scène a fait date dans l'histoire du cinéma et c'est une mini-uchronie redoutable de pertinence et d'efficacité.
Image colorisée : bonne. Très belle à voir même si le procédé de colorisation doit encore être amélioré. Les détails fins peuvent aller jusqu'aux cils mais les textures de peaux sont en général gommée par la couleur quasi uniforme ajoutée à l'image, qui ne tient pas compte des rougeurs de la peau liées aux émotions, des variations de pigmentation naturelle, des petits défauts, ou des détails du maquillage d'époque. Le même problème peut se retrouver à n'importe quel niveau de l'image (décor, vêtement etc.), mais dès que les contrastes des détails sont fort (par exemple le costume du héros) ou certains objets du décors, l'illusion de la couleur est presque parfaite.
Image originale noir et blanc : Très bonne.
Son : original anglais Dolby Digital Mono : Bon. Sonne très bien, agréable, même s'il est un peu daté d'allure.
Bonus: Limités (bande annonce, comparaison d'images).
Il vaut mieux acheter l'édition américaine multi-régions, avec piste et sous-titres français, et les vrais bonus, mêmes s'ils ne sont pas non plus très nombreux. La version colorisée est agréable à regarder, même si la version noir et blanc est encore plus belle et que l'imagination n'aura pas le côté encore trop artificiel de la colorisation au niveau des peaux.




***
2012, le film de 2009
- Détails
- Écrit par David Sicé
- Catégorie : Blog
- Affichages : 3978

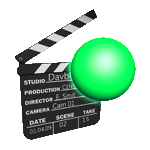
2012 (2009)
Sorti en France et aux USA le 11 novembre 2009.
Sorti en Angleterre le 13 novembre 2009.
Sorti en blu-ray américain le 2 mars 2010.
Sorti en blu-ray en France le 11 mars 2010 (multi-régions).
De Roland Emmerich (également scénariste), sur un scénario de Harald Kloser ; avec John Cusack, Amanda Peet , Thandie Newton, Chiwetel Ejiofor, Oliver Platt, Tom McCarthy, Woody Harrelson, Danny Glover, Liam James, Morgan Lily, Zlatko Buric, Beatrice Rosen, Alexandre Haussmann, Philippe Haussmann, Johann Urb, Jimi Mistry , Osric Chau, Patrick Bauchau, Blu Mankuma, John Billingsley, Stephen McHattie, Chin Han.
Pour adultes et adolescents.
Le système solaire – Saturne, Jupiter, la Terre, Vénus, Mercure… le Soleil et ses éruptions solaires. En 2009, l’Inde, sous une pluie battante. Un taxi asperge un enfant jouant avec un bateau dans une flaque, avant de déposer le Dr. Adrian Hemsley chez Satam, le responsable d’une station d’étude des profondeurs de la Terre dans la mine la plus profonde de la Terre. En bas du puits, il règne une chaleur infernale. Satam présente Adrian le Dr. Lokesh, spécialiste de la physique quantique. Puis il lui montre sur un écran le compte des neutrinos traversant le réservoir d’eau. Avec les dernières éruptions solaires, le compte a brutalement augmenté et Satam affirme que le flot des neutrinos cause désormais pour la première fois une réaction physique au sein de la Terre. L’hypothèse de Satam est que les neutrinos ont mutés en une nouvelle particule qui réchauffe à la manière d’un four à micro-onde le cœur de la Terre. Et pour preuve, il lui ouvre un sas donnant sur le réservoir d’eau, que les neutrinos portent désormais à ébullition.
Horrifié, Adrian est reparti pour Washington, où il interrompt la petite fête de levée de fond d’un officiel, Anheiser, pour pouvoir lui parler d’urgence. Il est d’abord bloqué parce qu’il ne porte pas de veste. Il en emprunte donc la veste d’un collègue et parvient à entrer et parler à Anheiser, qui d’abord lui demande de prendre rendez-vous pour plusieurs. Adrian insiste et Anheiser finit par lire le rapport. Anheiser annonce alors que Adrian ne travaille plus pour les services géologiques, mais pour lui, et l’emmène d’urgence à la Maison Blanche. Plus tard, au sommet du G8 de 2010, le président fait sortir tous les traducteurs de la salle où sont réunis les chefs d’état, expliquant qu’ils n’auront pas besoin de comprendre les finesses de langage de l’anglais pour comprendre ce qu’il a à leur dire : six mois auparavant, on l’a informé d’une situation si catastrophique qu’il refusait d’abord d’y croire. Mais à présent, il en est certain : le monde tels qu’ils le connaissent arrivera très bientôt à sa fin.
Plus tard, dans la vallée de Cho-Min au Tibet, en 2010 : Les chinois déportent les populations locales, et tandis que les familles s’en vont, les hommes qui veulent travailler restent tandis que les chinois font l’inventaire de leurs connaissances, et les premières détonations pour creuser une mine retentissent. En 2011, un émir est démarché dans un grand hôtel Londonien par un certain Monsieur Isaacs, qui lui demande un milliard d’Euro pour mettre en sécurité sa famille, tandis qu’au musée du Louvres, la propre fille du président, représentante de l’organisation Héritage, a obtenu du directeur du Louvres de lui confier les chefs-d’œuvres du musée afin qu’elle les mette en sécurité des attentats terroristes au fond d’un coffre dans les profondeurs de la Suisse.
En 2012, au Guatemala, une secte a organisé un suicide collectif à cause d’une prédiction Maya selon laquelle la fin du monde serait pour le 12 décembre. Étrangement, les scientifiques prévoient l’éruption solaire la plus intense pour cette date. Jackson Curtis, un romancier divorcé chauffeur de Limousine habitant la Californie se réveille en sursaut ce matin-là, car il doit emmener ses enfants en vacances. Sa voiture ordinaire est en panne, Jackson doit donc prendre sa limousine et se trouve déjà en retard. Il ne prête donc aucune attention aux « fractures de surfaces » qui se sont multipliées sur la côte Pacifique ces derniers jours. Son ex-femme est à présent avec un chirurgien esthétique, et Jackson ignorait que sa fille de 7 ans mouillait encore son lit la nuit. Son ex lui rappelle de ne pas laisser l’aîné jouer tout le temps à l’ordinateur, puis c’est le départ.
C’est aussi le départ, mais en croisière, pour deux vieux Jazzmen qui doivent se produire à bord. L’un d’eux n’est autre que le père d’Adrian. Alors qu’il sont sur la passerelle d’embarquement, le bateau monte et descend d’un coup, comme si la terre ou le niveau de la mer avait soudain changé. Mais très vite tout redevient normal. Et comme Jackson roule vers Yellowstone avec ses enfants, ils aperçoivent des hélicoptères filer dans le ciel, tandis qu’une radio-pirate commente l’évènement en direct. L’explication ? L’équipe menée par Adrian Hemsley s’est trompé dans ses prévisions : la fin du monde serait en avance de plusieurs mois. Alors qu’Adrian explique cela au président des Etats-Unis à Washington, la fille de ce dernier débarque furieuse dans le bureau ovale : elle avait le directeur du Louvre au téléphone au moment où celui-ci est mort dans un accident de voiture spectaculaire. Or celui-ci accusait l’organisation Héritage de ne pas exister : les œuvres du Louvre n’étaient pas où elles auraient dû se trouver.





***
Donnez votre avis sur ce film en nous rejoignant sur le forum Philippe-Ebly.fr
***
L'assistant du vampire, le film de 2009
- Détails
- Écrit par David Sicé
- Catégorie : Blog
- Affichages : 3555

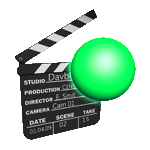
Ici la page Amazon.fr du blu-ray français de l'Assistant du vampire (2009)
Cirque du Freak: The Vampire's Assistant (2009)
Sorti en aux USA et en Angleterre le 23 octobre 2009.
Sorti en France le 2 décembre 2009.
Sorti en blu-ray aux USA et en France le 23 février 2010 (multi-régions, version et sous-titres français inclus)
De Paul Weitz (également scénariste), sur un scénario de Brian Helgeland , d'après le roman de Darren Shan. Avec Chris Massoglia, Josh Hutcherson, Jessica Carlson, Patrick Fugit, John C. Reilly, Ken Watanabe, Salma Hayek, Michael Cerveris, Ray Stevenson, Willem Dafoe, Morgan Saylor, Orlando Jones.
Pour adultes et adolescents.
Un peu à l’écart, un gros homme amusé mange du pop-corn à un enterrement, celui de Darren Shaw, un adolescent – lequel, de son propre aveux, n’avait jamais prévu de passer autant de temps au fond d’un cercueil… à jouer avec sa console de jeu portable, ce alors même que son meilleur ami, Steve, bouleversé, va déposer une fleur sur sa tombe.
Quelques jours auparavant, au lycée Beckman, Darren suivait une scolarité ordinaire. Il était relativement populaire, avait des notes suffisantes pour rendre sa famille fière. Son seul défaut, avoir Steve pour meilleur ami. Steve est du genre à faire n’importe quoi, comme entraîner Darren sur le toit pour sécher le cour d’Histoire, et lui faire casser bruyamment des ampoules à coup de pierres. Darren se fait bien sûr pincer, et à la maison, c’est le drame : pour sa famille, il s’écarte de la voie toute tracée : l’université, un travail, fonder une famille et hurler sur son fils. Le lendemain, Steve est choqué d’apprendre qu’il est devenu le meilleur ami secret de Darren, et lui reproche de faire toujours ce que ses parents veulent. Puis il commence à admettre que les parents de Darren ont raison, il n’est qu’une ordure et ils ne devraient plus se fréquenter, mais Darren proteste : Steve est bien son meilleur ami, il n’est pas une ordure.
C’est alors qu’une limousine passe devant eux et leur jette un tract pour un spectacle de monstre qui doit avoir lieu le soir même en ville. En cours d’histoire, le professeur confisque le tract et déclare que c’est odieux d’exploiter des monstres pour de l’argent. Cependant, Darren file par sa fenêtre et rejoindre Steve pour aller rejoindre à vélo l’adresse du spectacle. Steve lui fait remarquer que la lune de ce soir est rousse – ou plus exactement sanglante. Steve en effet est obsédé par les vampires, tandis que Darren adore les araignées. Devant le guichet, ils découvrent un panneau : « de retour dans trois secondes ». Darren compte jusqu’à trois… Une petite trappe sous le guichet s’ouvre, et un bout de carton sur lequel est écrit « argent » atterrit par terre. Steve tend l’argent, et une main arrache les billets et referme la trappe. Steve s’énerve, frappe à la trappe qui s’ouvre, il tend la main, et une espèce de gnome grimaçant attrape sa main et le mord, puis la chose jette les tickets par terre.
Darren et Steve entre alors dans le hall du théâtre. Ils se retrouvent face à un géant asiatique au crâne déformé, qui leur demande s’ils ont 21 ans. Comme les deux adolescents restent bouche-bée, il ajoute rapidement, plus bas : « dites ‘oui’ ». Et Darren et Steve répondent précipitamment « oui ». Puis il leur demande s’ils sont ordinairement tendance à la panique, ou à l’arrêt cardiaque soudain ou aux crises d’anxiété, et comme à nouveau les deux adolescents hésitent, il leur souffle : « dites ‘non’ ». Et ils répondent « non ».
***
***

